"Les mémoires d''une âme" : prêt pour l''écrit ? - Victor Hugo
1856, Victor Hugo publie Les Contemplations.
2021, Mr. LeBac le remet au programme, avec un indice pour en baliser la lecture : « les mémoires d'une âme ».
T'auras compris : c'est un recueil de tourment et de larmes, et ça fait 176 ans que ça dure !...

Mais ici, on ne lira exhaustivement tous les poèmes ; ici on va se poser les bonnes questions pour mieux comprendre c'tte affaire, « les mémoires d'une âme », au programme de l'Education nationale pour le bac 2020.
Parce qu'en réalité, baliser ce thème c'est baliser l'ensemble des sujets possibles de dissertation pour l'écrit du bac !
L'Archiprof se répète : ce ne sera ni la première fois ni la dernière mais c'est quelque chose à bien avoir en tête. Avant la réforme du bac, le sujet de dissertation pouvait toucher à tous les thèmes imaginables : ça nécessitait une énorme capacité d'improvisation et une vaste culture littéraire. Du coup la dissertation avait une réputation d'excellence, que se réservait les meilleurs élèves le plus souvent...
En 2020, il suffit d'apprendre et de recracher 1 cours.
En l'occurrence, 1 cours sur « Les mémoires d'une âme »...
On aura beau prendre dans tous les sens ce thème, grosso modo, on n'en tirera jamais qu'un seul plan logique, et c'est ce plan qu'il faut savoir faire varier selon les termes du sujet le jour de l'épreuve.
Un seul plan et tu réponds à tous les sujets possibles.
Et c'est un hold-up qui est approuvé par l'Etat stp...

Donc voyons voir pas à pas ce qu'il en est. Un mot à la fois, pour faire simple."
1856, Victor Hugo publie Les Contemplations.
2021, Mr. LeBac le remet au programme, avec un indice pour en baliser la lecture : « les mémoires d'une âme ».
T'auras compris : c'est un recueil de tourment et de larmes, et ça fait 176 ans que ça dure !...

Mais ici, on ne lira exhaustivement tous les poèmes ; ici on va se poser les bonnes questions pour mieux comprendre c'tte affaire, « les mémoires d'une âme », au programme de l'Education nationale pour le bac 2020.
Parce qu'en réalité, baliser ce thème c'est baliser l'ensemble des sujets possibles de dissertation pour l'écrit du bac !
L'Archiprof se répète : ce ne sera ni la première fois ni la dernière mais c'est quelque chose à bien avoir en tête. Avant la réforme du bac, le sujet de dissertation pouvait toucher à tous les thèmes imaginables : ça nécessitait une énorme capacité d'improvisation et une vaste culture littéraire. Du coup la dissertation avait une réputation d'excellence, que se réservait les meilleurs élèves le plus souvent...
En 2020, il suffit d'apprendre et de recracher 1 cours.
En l'occurrence, 1 cours sur « Les mémoires d'une âme »...
On aura beau prendre dans tous les sens ce thème, grosso modo, on n'en tirera jamais qu'un seul plan logique, et c'est ce plan qu'il faut savoir faire varier selon les termes du sujet le jour de l'épreuve.
Un seul plan et tu réponds à tous les sujets possibles.
Et c'est un hold-up qui est approuvé par l'Etat stp...

Donc voyons voir pas à pas ce qu'il en est. Un mot à la fois, pour faire simple."
"Les mémoires d''une âme" : prêt pour l''écrit ? - Victor Hugo
"Les mémoires d''une âme" : prêt pour l''écrit ? - Victor Hugo
I. « âme » : le registre lyrique, toujours et encore...
L'âme du poète. De quoi s'agit-il ?
L'âme n'est pas l'esprit qui calcule ou réfléchit ni le corps aux besoins duquel il faut subvenir. L'âme renvoie en premier lieu à l'idée de sensibilité intérieure. Symboliquement, on la rattache au cœur, comme lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a du cœur, et aux émotions fortes : l'amour, par exemple, se définit comme un dialogue des âmes, qui va précisément plus loin que l'attraction des corps et le désir strictement sexuel.
Donc, « âme » signale ici que l'attention est portée sur les émotions et la vie affective avant tout.
Rien d'étonnant à cela puisqu'on a affaire à un poète, et le fond de commerce de la poésie depuis des siècles et des siècles c'est justement l'expression versifiée d'émotions fortes.
Là, tu dois penser à une notion centrale en littérature : le registre lyrique.
Registre et pas mouvement !
Un registre, c'est une manière générale d'écrire caractérisée par un ton particulier et un objectif simple. Par exemple le registre comique avec son ton grotesque qui vise à faire rire.
Un mouvement, c'est un regroupement d'oeuvres et d'auteurs en lien avec un contexte historique précis, à l'origine d'une théorie sur la littérature qui est portée par des chefs de file. Par exemple le mouvement romantique défendu par Victor Hugo qui définit les règles et buts du drame romantique dans ses préfaces.
Le registre lyrique, c'est quoi ?
Simple. C'est simple : quand dans un texte de poésie (en vers surtout), un poète se met en avant, principalement en employant le pronom « je », pour exprimer les émotions qu'il a sur le cœur.
D'où la célèbre équation made-in Archiprof à revoir !
Là, il te paraît clair le lien étroit entre l'idée de l'âme et le registre lyrique en poésie : s'il y a une forme d'expression à même de laisser parler l'âme, c'est bien le lyrisme !
L'âme chante, elle roucoule, dans les vers lyriques !
II. « mémoires » : le genre autobiographique?
Okay, les choses se compliquent à ce point, pas la peine d'essayer de le cacher... « Mémoires » : c'est même sur cette notion que démarre la machine à faire des problématiques, de beaux petits sujets pour les dissertations du bac de français...
Bon, au premier abord, l'idée paraît toute simple : par mémoire, il faut entendre ce regard rétrospectif (=qui retourne en arrière) par lequel un individu se remémore son passé. La construction des Contemplations met en avant cette idée : elle se divise en deux grandes parties, deux Livres, d'un côté « Autrefois » et de l'autre « Aujourd'hui ».
Donc il est bien question du souvenir, reliant passé et présent...
Sauf que « mémoires », au pluriel, ce n'est déjà plus la mémoire, la stricte faculté mentale.
Au pluriel, cela fait référence à une sous-catégorie du genre autobiographique...
L'autobiographie, c'est quoi ?
C'est un genre littéraire caractérisé par une idée toute simple : un récit non-fictif où l'auteur raconte sa vie. Certes l'idée est simple mais les formes dérivées sont illimitées.
Tu t'imagines bien que tous ces gros narcissiques d'hommes de lettres n'ont pas cessé d'inventer des nouvelles manières de raconter leurs vies...

Journal, autoportrait, confessions, correspondances, récit d'enfance, fragments etc. Ils ont tout essayé pour se donner un genre alors qu'il balançait leur story sur papier.
Et « mémoires » donc ?
La particularité des Mémoires tient à leur dimension historique : l'auteur y retrace bien sa vie mais en l'inscrivant dans un contexte historique où les actions personnelles ont pour écho les évènements de l'époque.
Typiquement, dans ses Mémoires de guerre, le Général de Gaulle raconte son action à la tête de la France Libre durant la 2ème guerre mondiale : sa petite vie n'a de sens qu'en ce qu'elle témoigne des bouleversements mondiaux et de la lutte contre le nazisme et la collaboration vichyste.
Donc là, on tient une incohérence...
Comment tirer des « mémoires » d'une « âme » ? Comment donner une portée historique à des émotions personnelles et intérieures ?...
III. L'Histoire avec le grand H d'Hugo...
En plus le fait est que Victor Hugo aurait pu tirer des Mémoires de sa vie : il a eu un rôle politique de premier plan au cours de la IIème République, à l'honneur pour les E3C 2021 (lülz c'est une vanne). Il s'est fait connaître par de nombreuses prises de position, ne manquant jamais de réagir à l'actualité politique et sociale de son époque.
1856 : il publie Les Contemplations.
Mais c'est en exil qu'il le fait, sur l'île de Guernessey ; en 1851, il a fui le coup d'état de Napoléon III qui met fin au régime républicain.

Certains poème en parlent d'ailleurs, évoquant les questions de lutte politique, le sentiment d'injustice et l'indignation face à la tyrannie en France.
Plus généralement, il a été le chef de file de la génération romantique, favorable aux idéaux révolutionnaires de 1789 et à l'avant-garde de la création littéraire.
Il a donc prétendu transformer de fond en comble les mentalités, en ramenant la liberté au cœur des Lettres.
Avec ses drames romantiques, il a même provoqué des clashs d'anthologie.

1830 : la première de sa pièce Hernani provoque un tollé monstre.
Son refus des règles du théâtre classique divise : d'un côté les vieux partisans du classicisme, de l'autre les jeunes romantiques. Ca se hurle dessus, ça traite les mamans ; quelques coups de canne sont même lâchés ici et là.
Non on n'a pas attendu le Duty Free d'Orly pour jouer les sauvageons.

Mais dans Les Contemplations, cette Histoire, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle, n'est pas du tout au centre de l'oeuvre...
En fait Hugo jugeait avoir déjà fait sa part du taff sur le plan politique et militant.
1853 : il publie les Châtiments, recueil de poèmes satiriques où il critique, dénonce, maudit le régime de Napoléon III.
En vérité, Hugo souhaitait faire des Contemplations le contrepoint des Châtiments : l'idée, c'était d'en revenir à de la pure poésie, détachée de toute considérations sur l'actualité politique.
De la pure poésie entièrement tournée vers le souvenir du passé ; c'est pour cette raison qu'on y retrouve tant de poèmes écrits durant les années 1830, en pleine période romantique.
Pourtant, quand on lit Les Contemplations, c'est bourré de dates, qui suivent l'ordre chronologique même, comme pour un récit historique. Plus encore, comme on l'a dit, le recueil dans son ensemble est divisé en deux livres : « Autrefois » et « Aujourd'hui »...
Mais Hugo disait ne vouloir aborder les sujets d'« Aujourd'hui » que dans les Châtiments...
S'il ne s'agit pas d'un « Aujourd'hui » politique, quel genre d'« Aujourd'hui » est-ce ?
Quel genre de « mémoires » est-ce ?
IV. La poésie extralucide de Victor Hugo
On n'ira pas très loin pour trouver la réponse, tkt.
Dès le tout début de Pauca Meae on tient notre indice-clé : une simple date.
4 septembre 1843...
Et du blanc ; pas un seul vers, juste du blanc.
Du blanc pendant trois ans.
Trois ans de blanc avant que Victor Hugo ne reprenne la plume, en septembre 1846 !
Cette date, isolée sur une page, c'est celle de la mort de sa fille Léopoldine Hugo. La malheureuse s'est noyée, ainsi que son récent mari qui tentait de la sauver, au beau milieu du voyage de noces.
Victor Hugo ne l'a su qu'indirectement, en tombant par hasard sur un article dans la presse, XIXème oblige.
Tu t'imagines, apprendre la mort d'un proche dans un RT, toi ?
Ce n'est pas la grande Histoire qui rythme les Contemplations, mais cette grande tragédie, tout à fait personnelle : la perte par un papa de sa fille adorée...
Ce n'est pas tout...
Un événement va vraiment pousser Hugo à approfondir cet aspect des Contemplations, le travail mémoriel du deuil. Et à le faire quitte à perturber le projet initial qui opposait étroitement l'actualité politique des Châtiments au souvenir poétique des Contemplations.
Septembre 1853 : Hugo s'initie au spiritisme.
Vrai de vrai : Hugo apprend à « faire tourner les tables », avec les potos, dans la nuit noire de Guernessey...

C'est crucial, et pour une raison aussi simple que pathétique en vérité...
Hugo se persuade être rentré en contact avec Léopoldine, sa fille défunte. Les mystères de la mort, de l'au-delà finissent par l'obséder au point d'influencer sa conception de la poésie.
A ses yeux le poète est un être d'exception, extralucide, et donc capable de percer les secrets qui se cachent sous l'apparence des choses.
En particulier la voix des âmes mortes, des spectres qui continuent d'hanter le royaume des vivants...
Bref le poète est un mage, affirmera Hugo, un prophète qui doit éclairer ses frères humains en partageant ses visions au travers de ses vers.
Donc s'il est question de « mémoires », ce n'est plus seulement en lien avec l'Histoire des sociétés, sur un plan politique comme pour les Châtiments, mais avec une Histoire plus grande encore !
Une Histoire universelle, touchant l'Humanité toute entière, celle des vivants comme des morts, des exilés politiques comme des enfants défunts !
Après tout, quand on y réfléchit, l'« âme », c'est aussi ce qui survit après la mort dans la culture occidentale, de la mythologie grecque à la religion chrétienne. L'« âme » est la part immatérielle de la personne, censée passer dans l'au-delà, pour rejoindre le paradis ou l'enfer, ou encore traîner sur terre et hanter les vivants.
D'où ce lien fort avec l'idée de mort ; et cette réorganisation du recueil, à partir de 1853, autour de la date fatale, en mémoire de Léopoldine. La tragédie personnelle ouvre la conscience d'Hugo aux mystères universels de la vie et de la mort...
V. Le mot de la fin : « une », carrément...
Où en est-on ?
« âme », on a rattaché ça à la sensibilité lyrique.
« mémoires », on a vu le lien avec la dimension autobiographique à laquelle manquait l'aspect historique cependant...
Mais avec la mort de Léopoldine et l'idée d'une poésie extralucide, on se rend compte que c'est à une Histoire plus grande encore que se rattache les Contemplations.
Mais on peut affiner encore !
Donc, comme les derniers des singes, on va retourner gratter l'énoncé du thème au programme : « les mémoires d'une âme ».
Que remarques-tu ?
Rien ?
Exactement !
Il reste un mot, un mot de rien du tout, un mot insignifiant. Le genre de mot qu'on ne remarque qu'au neuvième épisode de la saison 1 mais qui décide de toute la saison 2...
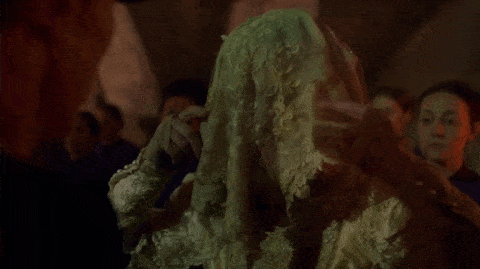
Entre « mémoires » et « âme », il nous reste « une ».
…
Hugo ne parle pas des mémoires de « son » âme ; pas plus qu'il ne parle des mémoires de « l' »âme
Vu l'aspect autobiographique qui passe par le registre lyrique, on aurait pu s'attendre à ce qu'il parle de « son » âme, mais non...
« une » âme, c'est à dire « une » âme indéfinie, « une » âme parmi d'autres. Ca pourrait « son » âme comme ça pourrait être « ton » âme ou l'âme du voisin. N'importe quelle âme !
Et là encore, on va faire simple. Cette expression « les mémoires d'une âme », elle est tirée de la préface des Contemplations en fait. Ce n'est pas l'Education nationale et Mister Bac qui sont derrière ; c'est Victor Hugo lui-même.
Et il suffit d'écouter la suite pour tout comprendre (oe on aurait pu le faire plus tôt, j'avoue...)

« Une destinée est écrite là jour à jour.
Est-ce donc la vie d’un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! »
Nobody :
Hugo :

Okay, maintenant on tient toutes les pièces du puzzle...
Les Contemplations partent d'éléments autobiographiques, dont le deuil de Léopoldine notamment mais pas seulement.
Cependant cette matière autobiographique est transformée par le lyrisme poétique : pour l'auteur, il ne s'agit pas de raconter simplement sa vie mais de communier avec le lecteur sur un plan émotionnel.
Dans le lyrisme leurs émotions et souffrances se confondent ; c'est-à-dire que les sentiments personnels d'Hugo acquièrent une portée universelle.
D'où l'idée de « destinée » : tous les hommes empruntent un chemin semblable, qui va des folies d'une jeunesse insouciante aux lassitudes d'une maturité angoissée par la mort.
Qu'importe ce que chacun fait dans le détail : ultimement tous les parcours, toutes les biographiques se résumeront à cette destinée commune, celle des Mortels !
Donc parler de sa vie à soi, à condition de lui donner un authentique souffle lyrique, permet de mettre à jour la vie de tous les êtres-humains.
Cela permet de tracer une Histoire universelle où jouent les grandes questions existentielles (l'amour, la lutte, la mort, Dieu etc.)
Eléments autobiographique + registre lyrique = l'âme « une » et universelle de l'Humanité.
T'as capté ?
De là, cette idée des « mémoires d'une âme » qui implique l'autobiographie, le lyrisme et la quête du sens universel de l'existence humaine.
Or, maintenant qu'on voit comment articuler toutes ces notions entre elles, on peut anticiper très simplement tous les sujets concernant Victor Hugo.
C'est pas compliqué : on voit que ce qu'il y a de problématique dans c'tte affaire, c'est l'opposition entre le personnel et l'universel.
Les Contemplations racontent la vie d'Hugo mais en même temps ça parle de la vie de tous les hommes. Il y expriment ses sentiments intimes mais ce sont des sentiments qu'on aura tous à vivre un jour.
Donc, le plan suivant un raisonnement dialectique sera plus ou moins toujours le même :
1 Oui!
Les Contemplations ont bien une dimension autobiographique.
2 Mais en même temps...
Elles mettent en avant un lyrisme non-autobiographique.
3 En fait...
Au-delà de l'autobiographie personnelle, elle vise avant tout un questionnement universel.
Pour approfondir ces éléments, voilà de quoi méditer : 2h de sujets de dissertation, décortiqués sans fraude aucune...
I. « âme » : le registre lyrique, toujours et encore...
L'âme du poète. De quoi s'agit-il ?
L'âme n'est pas l'esprit qui calcule ou réfléchit ni le corps aux besoins duquel il faut subvenir. L'âme renvoie en premier lieu à l'idée de sensibilité intérieure. Symboliquement, on la rattache au cœur, comme lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a du cœur, et aux émotions fortes : l'amour, par exemple, se définit comme un dialogue des âmes, qui va précisément plus loin que l'attraction des corps et le désir strictement sexuel.
Donc, « âme » signale ici que l'attention est portée sur les émotions et la vie affective avant tout.
Rien d'étonnant à cela puisqu'on a affaire à un poète, et le fond de commerce de la poésie depuis des siècles et des siècles c'est justement l'expression versifiée d'émotions fortes.
Là, tu dois penser à une notion centrale en littérature : le registre lyrique.
Registre et pas mouvement !
Un registre, c'est une manière générale d'écrire caractérisée par un ton particulier et un objectif simple. Par exemple le registre comique avec son ton grotesque qui vise à faire rire.
Un mouvement, c'est un regroupement d'oeuvres et d'auteurs en lien avec un contexte historique précis, à l'origine d'une théorie sur la littérature qui est portée par des chefs de file. Par exemple le mouvement romantique défendu par Victor Hugo qui définit les règles et buts du drame romantique dans ses préfaces.
Le registre lyrique, c'est quoi ?
Simple. C'est simple : quand dans un texte de poésie (en vers surtout), un poète se met en avant, principalement en employant le pronom « je », pour exprimer les émotions qu'il a sur le cœur.
D'où la célèbre équation made-in Archiprof à revoir !
Là, il te paraît clair le lien étroit entre l'idée de l'âme et le registre lyrique en poésie : s'il y a une forme d'expression à même de laisser parler l'âme, c'est bien le lyrisme !
L'âme chante, elle roucoule, dans les vers lyriques !
II. « mémoires » : le genre autobiographique?
Okay, les choses se compliquent à ce point, pas la peine d'essayer de le cacher... « Mémoires » : c'est même sur cette notion que démarre la machine à faire des problématiques, de beaux petits sujets pour les dissertations du bac de français...
Bon, au premier abord, l'idée paraît toute simple : par mémoire, il faut entendre ce regard rétrospectif (=qui retourne en arrière) par lequel un individu se remémore son passé. La construction des Contemplations met en avant cette idée : elle se divise en deux grandes parties, deux Livres, d'un côté « Autrefois » et de l'autre « Aujourd'hui ».
Donc il est bien question du souvenir, reliant passé et présent...
Sauf que « mémoires », au pluriel, ce n'est déjà plus la mémoire, la stricte faculté mentale.
Au pluriel, cela fait référence à une sous-catégorie du genre autobiographique...
L'autobiographie, c'est quoi ?
C'est un genre littéraire caractérisé par une idée toute simple : un récit non-fictif où l'auteur raconte sa vie. Certes l'idée est simple mais les formes dérivées sont illimitées.
Tu t'imagines bien que tous ces gros narcissiques d'hommes de lettres n'ont pas cessé d'inventer des nouvelles manières de raconter leurs vies...

Journal, autoportrait, confessions, correspondances, récit d'enfance, fragments etc. Ils ont tout essayé pour se donner un genre alors qu'il balançait leur story sur papier.
Et « mémoires » donc ?
La particularité des Mémoires tient à leur dimension historique : l'auteur y retrace bien sa vie mais en l'inscrivant dans un contexte historique où les actions personnelles ont pour écho les évènements de l'époque.
Typiquement, dans ses Mémoires de guerre, le Général de Gaulle raconte son action à la tête de la France Libre durant la 2ème guerre mondiale : sa petite vie n'a de sens qu'en ce qu'elle témoigne des bouleversements mondiaux et de la lutte contre le nazisme et la collaboration vichyste.
Donc là, on tient une incohérence...
Comment tirer des « mémoires » d'une « âme » ? Comment donner une portée historique à des émotions personnelles et intérieures ?...
III. L'Histoire avec le grand H d'Hugo...
En plus le fait est que Victor Hugo aurait pu tirer des Mémoires de sa vie : il a eu un rôle politique de premier plan au cours de la IIème République, à l'honneur pour les E3C 2021 (lülz c'est une vanne). Il s'est fait connaître par de nombreuses prises de position, ne manquant jamais de réagir à l'actualité politique et sociale de son époque.
1856 : il publie Les Contemplations.
Mais c'est en exil qu'il le fait, sur l'île de Guernessey ; en 1851, il a fui le coup d'état de Napoléon III qui met fin au régime républicain.

Certains poème en parlent d'ailleurs, évoquant les questions de lutte politique, le sentiment d'injustice et l'indignation face à la tyrannie en France.
Plus généralement, il a été le chef de file de la génération romantique, favorable aux idéaux révolutionnaires de 1789 et à l'avant-garde de la création littéraire.
Il a donc prétendu transformer de fond en comble les mentalités, en ramenant la liberté au cœur des Lettres.
Avec ses drames romantiques, il a même provoqué des clashs d'anthologie.

1830 : la première de sa pièce Hernani provoque un tollé monstre.
Son refus des règles du théâtre classique divise : d'un côté les vieux partisans du classicisme, de l'autre les jeunes romantiques. Ca se hurle dessus, ça traite les mamans ; quelques coups de canne sont même lâchés ici et là.
Non on n'a pas attendu le Duty Free d'Orly pour jouer les sauvageons.

Mais dans Les Contemplations, cette Histoire, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle, n'est pas du tout au centre de l'oeuvre...
En fait Hugo jugeait avoir déjà fait sa part du taff sur le plan politique et militant.
1853 : il publie les Châtiments, recueil de poèmes satiriques où il critique, dénonce, maudit le régime de Napoléon III.
En vérité, Hugo souhaitait faire des Contemplations le contrepoint des Châtiments : l'idée, c'était d'en revenir à de la pure poésie, détachée de toute considérations sur l'actualité politique.
De la pure poésie entièrement tournée vers le souvenir du passé ; c'est pour cette raison qu'on y retrouve tant de poèmes écrits durant les années 1830, en pleine période romantique.
Pourtant, quand on lit Les Contemplations, c'est bourré de dates, qui suivent l'ordre chronologique même, comme pour un récit historique. Plus encore, comme on l'a dit, le recueil dans son ensemble est divisé en deux livres : « Autrefois » et « Aujourd'hui »...
Mais Hugo disait ne vouloir aborder les sujets d'« Aujourd'hui » que dans les Châtiments...
S'il ne s'agit pas d'un « Aujourd'hui » politique, quel genre d'« Aujourd'hui » est-ce ?
Quel genre de « mémoires » est-ce ?
IV. La poésie extralucide de Victor Hugo
On n'ira pas très loin pour trouver la réponse, tkt.
Dès le tout début de Pauca Meae on tient notre indice-clé : une simple date.
4 septembre 1843...
Et du blanc ; pas un seul vers, juste du blanc.
Du blanc pendant trois ans.
Trois ans de blanc avant que Victor Hugo ne reprenne la plume, en septembre 1846 !
Cette date, isolée sur une page, c'est celle de la mort de sa fille Léopoldine Hugo. La malheureuse s'est noyée, ainsi que son récent mari qui tentait de la sauver, au beau milieu du voyage de noces.
Victor Hugo ne l'a su qu'indirectement, en tombant par hasard sur un article dans la presse, XIXème oblige.
Tu t'imagines, apprendre la mort d'un proche dans un RT, toi ?
Ce n'est pas la grande Histoire qui rythme les Contemplations, mais cette grande tragédie, tout à fait personnelle : la perte par un papa de sa fille adorée...
Ce n'est pas tout...
Un événement va vraiment pousser Hugo à approfondir cet aspect des Contemplations, le travail mémoriel du deuil. Et à le faire quitte à perturber le projet initial qui opposait étroitement l'actualité politique des Châtiments au souvenir poétique des Contemplations.
Septembre 1853 : Hugo s'initie au spiritisme.
Vrai de vrai : Hugo apprend à « faire tourner les tables », avec les potos, dans la nuit noire de Guernessey...

C'est crucial, et pour une raison aussi simple que pathétique en vérité...
Hugo se persuade être rentré en contact avec Léopoldine, sa fille défunte. Les mystères de la mort, de l'au-delà finissent par l'obséder au point d'influencer sa conception de la poésie.
A ses yeux le poète est un être d'exception, extralucide, et donc capable de percer les secrets qui se cachent sous l'apparence des choses.
En particulier la voix des âmes mortes, des spectres qui continuent d'hanter le royaume des vivants...
Bref le poète est un mage, affirmera Hugo, un prophète qui doit éclairer ses frères humains en partageant ses visions au travers de ses vers.
Donc s'il est question de « mémoires », ce n'est plus seulement en lien avec l'Histoire des sociétés, sur un plan politique comme pour les Châtiments, mais avec une Histoire plus grande encore !
Une Histoire universelle, touchant l'Humanité toute entière, celle des vivants comme des morts, des exilés politiques comme des enfants défunts !
Après tout, quand on y réfléchit, l'« âme », c'est aussi ce qui survit après la mort dans la culture occidentale, de la mythologie grecque à la religion chrétienne. L'« âme » est la part immatérielle de la personne, censée passer dans l'au-delà, pour rejoindre le paradis ou l'enfer, ou encore traîner sur terre et hanter les vivants.
D'où ce lien fort avec l'idée de mort ; et cette réorganisation du recueil, à partir de 1853, autour de la date fatale, en mémoire de Léopoldine. La tragédie personnelle ouvre la conscience d'Hugo aux mystères universels de la vie et de la mort...
V. Le mot de la fin : « une », carrément...
Où en est-on ?
« âme », on a rattaché ça à la sensibilité lyrique.
« mémoires », on a vu le lien avec la dimension autobiographique à laquelle manquait l'aspect historique cependant...
Mais avec la mort de Léopoldine et l'idée d'une poésie extralucide, on se rend compte que c'est à une Histoire plus grande encore que se rattache les Contemplations.
Mais on peut affiner encore !
Donc, comme les derniers des singes, on va retourner gratter l'énoncé du thème au programme : « les mémoires d'une âme ».
Que remarques-tu ?
Rien ?
Exactement !
Il reste un mot, un mot de rien du tout, un mot insignifiant. Le genre de mot qu'on ne remarque qu'au neuvième épisode de la saison 1 mais qui décide de toute la saison 2...
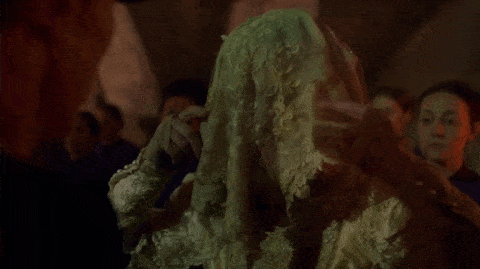
Entre « mémoires » et « âme », il nous reste « une ».
…
Hugo ne parle pas des mémoires de « son » âme ; pas plus qu'il ne parle des mémoires de « l' »âme
Vu l'aspect autobiographique qui passe par le registre lyrique, on aurait pu s'attendre à ce qu'il parle de « son » âme, mais non...
« une » âme, c'est à dire « une » âme indéfinie, « une » âme parmi d'autres. Ca pourrait « son » âme comme ça pourrait être « ton » âme ou l'âme du voisin. N'importe quelle âme !
Et là encore, on va faire simple. Cette expression « les mémoires d'une âme », elle est tirée de la préface des Contemplations en fait. Ce n'est pas l'Education nationale et Mister Bac qui sont derrière ; c'est Victor Hugo lui-même.
Et il suffit d'écouter la suite pour tout comprendre (oe on aurait pu le faire plus tôt, j'avoue...)

« Une destinée est écrite là jour à jour.
Est-ce donc la vie d’un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! »
Nobody :
Hugo :

Okay, maintenant on tient toutes les pièces du puzzle...
Les Contemplations partent d'éléments autobiographiques, dont le deuil de Léopoldine notamment mais pas seulement.
Cependant cette matière autobiographique est transformée par le lyrisme poétique : pour l'auteur, il ne s'agit pas de raconter simplement sa vie mais de communier avec le lecteur sur un plan émotionnel.
Dans le lyrisme leurs émotions et souffrances se confondent ; c'est-à-dire que les sentiments personnels d'Hugo acquièrent une portée universelle.
D'où l'idée de « destinée » : tous les hommes empruntent un chemin semblable, qui va des folies d'une jeunesse insouciante aux lassitudes d'une maturité angoissée par la mort.
Qu'importe ce que chacun fait dans le détail : ultimement tous les parcours, toutes les biographiques se résumeront à cette destinée commune, celle des Mortels !
Donc parler de sa vie à soi, à condition de lui donner un authentique souffle lyrique, permet de mettre à jour la vie de tous les êtres-humains.
Cela permet de tracer une Histoire universelle où jouent les grandes questions existentielles (l'amour, la lutte, la mort, Dieu etc.)
Eléments autobiographique + registre lyrique = l'âme « une » et universelle de l'Humanité.
T'as capté ?
De là, cette idée des « mémoires d'une âme » qui implique l'autobiographie, le lyrisme et la quête du sens universel de l'existence humaine.
Or, maintenant qu'on voit comment articuler toutes ces notions entre elles, on peut anticiper très simplement tous les sujets concernant Victor Hugo.
C'est pas compliqué : on voit que ce qu'il y a de problématique dans c'tte affaire, c'est l'opposition entre le personnel et l'universel.
Les Contemplations racontent la vie d'Hugo mais en même temps ça parle de la vie de tous les hommes. Il y expriment ses sentiments intimes mais ce sont des sentiments qu'on aura tous à vivre un jour.
Donc, le plan suivant un raisonnement dialectique sera plus ou moins toujours le même :
1 Oui!
Les Contemplations ont bien une dimension autobiographique.
2 Mais en même temps...
Elles mettent en avant un lyrisme non-autobiographique.
3 En fait...
Au-delà de l'autobiographie personnelle, elle vise avant tout un questionnement universel.
Pour approfondir ces éléments, voilà de quoi méditer : 2h de sujets de dissertation, décortiqués sans fraude aucune...
I. « âme » : le registre lyrique, toujours et encore...
L'âme du poète. De quoi s'agit-il ?
L'âme n'est pas l'esprit qui calcule ou réfléchit ni le corps aux besoins duquel il faut subvenir. L'âme renvoie en premier lieu à l'idée de sensibilité intérieure. Symboliquement, on la rattache au cœur, comme lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a du cœur, et aux émotions fortes : l'amour, par exemple, se définit comme un dialogue des âmes, qui va précisément plus loin que l'attraction des corps et le désir strictement sexuel.
Donc, « âme » signale ici que l'attention est portée sur les émotions et la vie affective avant tout.
Rien d'étonnant à cela puisqu'on a affaire à un poète, et le fond de commerce de la poésie depuis des siècles et des siècles c'est justement l'expression versifiée d'émotions fortes.
Là, tu dois penser à une notion centrale en littérature : le registre lyrique.
Registre et pas mouvement !
Un registre, c'est une manière générale d'écrire caractérisée par un ton particulier et un objectif simple. Par exemple le registre comique avec son ton grotesque qui vise à faire rire.
Un mouvement, c'est un regroupement d'oeuvres et d'auteurs en lien avec un contexte historique précis, à l'origine d'une théorie sur la littérature qui est portée par des chefs de file. Par exemple le mouvement romantique défendu par Victor Hugo qui définit les règles et buts du drame romantique dans ses préfaces.
Le registre lyrique, c'est quoi ?
Simple. C'est simple : quand dans un texte de poésie (en vers surtout), un poète se met en avant, principalement en employant le pronom « je », pour exprimer les émotions qu'il a sur le cœur.
D'où la célèbre équation made-in Archiprof à revoir !
Là, il te paraît clair le lien étroit entre l'idée de l'âme et le registre lyrique en poésie : s'il y a une forme d'expression à même de laisser parler l'âme, c'est bien le lyrisme !
L'âme chante, elle roucoule, dans les vers lyriques !
II. « mémoires » : le genre autobiographique?
Okay, les choses se compliquent à ce point, pas la peine d'essayer de le cacher... « Mémoires » : c'est même sur cette notion que démarre la machine à faire des problématiques, de beaux petits sujets pour les dissertations du bac de français...
Bon, au premier abord, l'idée paraît toute simple : par mémoire, il faut entendre ce regard rétrospectif (=qui retourne en arrière) par lequel un individu se remémore son passé. La construction des Contemplations met en avant cette idée : elle se divise en deux grandes parties, deux Livres, d'un côté « Autrefois » et de l'autre « Aujourd'hui ».
Donc il est bien question du souvenir, reliant passé et présent...
Sauf que « mémoires », au pluriel, ce n'est déjà plus la mémoire, la stricte faculté mentale.
Au pluriel, cela fait référence à une sous-catégorie du genre autobiographique...
L'autobiographie, c'est quoi ?
C'est un genre littéraire caractérisé par une idée toute simple : un récit non-fictif où l'auteur raconte sa vie. Certes l'idée est simple mais les formes dérivées sont illimitées.
Tu t'imagines bien que tous ces gros narcissiques d'hommes de lettres n'ont pas cessé d'inventer des nouvelles manières de raconter leurs vies...

Journal, autoportrait, confessions, correspondances, récit d'enfance, fragments etc. Ils ont tout essayé pour se donner un genre alors qu'il balançait leur story sur papier.
Et « mémoires » donc ?
La particularité des Mémoires tient à leur dimension historique : l'auteur y retrace bien sa vie mais en l'inscrivant dans un contexte historique où les actions personnelles ont pour écho les évènements de l'époque.
Typiquement, dans ses Mémoires de guerre, le Général de Gaulle raconte son action à la tête de la France Libre durant la 2ème guerre mondiale : sa petite vie n'a de sens qu'en ce qu'elle témoigne des bouleversements mondiaux et de la lutte contre le nazisme et la collaboration vichyste.
Donc là, on tient une incohérence...
Comment tirer des « mémoires » d'une « âme » ? Comment donner une portée historique à des émotions personnelles et intérieures ?...
III. L'Histoire avec le grand H d'Hugo...
En plus le fait est que Victor Hugo aurait pu tirer des Mémoires de sa vie : il a eu un rôle politique de premier plan au cours de la IIème République, à l'honneur pour les E3C 2021 (lülz c'est une vanne). Il s'est fait connaître par de nombreuses prises de position, ne manquant jamais de réagir à l'actualité politique et sociale de son époque.
1856 : il publie Les Contemplations.
Mais c'est en exil qu'il le fait, sur l'île de Guernessey ; en 1851, il a fui le coup d'état de Napoléon III qui met fin au régime républicain.

Certains poème en parlent d'ailleurs, évoquant les questions de lutte politique, le sentiment d'injustice et l'indignation face à la tyrannie en France.
Plus généralement, il a été le chef de file de la génération romantique, favorable aux idéaux révolutionnaires de 1789 et à l'avant-garde de la création littéraire.
Il a donc prétendu transformer de fond en comble les mentalités, en ramenant la liberté au cœur des Lettres.
Avec ses drames romantiques, il a même provoqué des clashs d'anthologie.

1830 : la première de sa pièce Hernani provoque un tollé monstre.
Son refus des règles du théâtre classique divise : d'un côté les vieux partisans du classicisme, de l'autre les jeunes romantiques. Ca se hurle dessus, ça traite les mamans ; quelques coups de canne sont même lâchés ici et là.
Non on n'a pas attendu le Duty Free d'Orly pour jouer les sauvageons.

Mais dans Les Contemplations, cette Histoire, qu'elle soit politique, sociale ou culturelle, n'est pas du tout au centre de l'oeuvre...
En fait Hugo jugeait avoir déjà fait sa part du taff sur le plan politique et militant.
1853 : il publie les Châtiments, recueil de poèmes satiriques où il critique, dénonce, maudit le régime de Napoléon III.
En vérité, Hugo souhaitait faire des Contemplations le contrepoint des Châtiments : l'idée, c'était d'en revenir à de la pure poésie, détachée de toute considérations sur l'actualité politique.
De la pure poésie entièrement tournée vers le souvenir du passé ; c'est pour cette raison qu'on y retrouve tant de poèmes écrits durant les années 1830, en pleine période romantique.
Pourtant, quand on lit Les Contemplations, c'est bourré de dates, qui suivent l'ordre chronologique même, comme pour un récit historique. Plus encore, comme on l'a dit, le recueil dans son ensemble est divisé en deux livres : « Autrefois » et « Aujourd'hui »...
Mais Hugo disait ne vouloir aborder les sujets d'« Aujourd'hui » que dans les Châtiments...
S'il ne s'agit pas d'un « Aujourd'hui » politique, quel genre d'« Aujourd'hui » est-ce ?
Quel genre de « mémoires » est-ce ?
IV. La poésie extralucide de Victor Hugo
On n'ira pas très loin pour trouver la réponse, tkt.
Dès le tout début de Pauca Meae on tient notre indice-clé : une simple date.
4 septembre 1843...
Et du blanc ; pas un seul vers, juste du blanc.
Du blanc pendant trois ans.
Trois ans de blanc avant que Victor Hugo ne reprenne la plume, en septembre 1846 !
Cette date, isolée sur une page, c'est celle de la mort de sa fille Léopoldine Hugo. La malheureuse s'est noyée, ainsi que son récent mari qui tentait de la sauver, au beau milieu du voyage de noces.
Victor Hugo ne l'a su qu'indirectement, en tombant par hasard sur un article dans la presse, XIXème oblige.
Tu t'imagines, apprendre la mort d'un proche dans un RT, toi ?
Ce n'est pas la grande Histoire qui rythme les Contemplations, mais cette grande tragédie, tout à fait personnelle : la perte par un papa de sa fille adorée...
Ce n'est pas tout...
Un événement va vraiment pousser Hugo à approfondir cet aspect des Contemplations, le travail mémoriel du deuil. Et à le faire quitte à perturber le projet initial qui opposait étroitement l'actualité politique des Châtiments au souvenir poétique des Contemplations.
Septembre 1853 : Hugo s'initie au spiritisme.
Vrai de vrai : Hugo apprend à « faire tourner les tables », avec les potos, dans la nuit noire de Guernessey...

C'est crucial, et pour une raison aussi simple que pathétique en vérité...
Hugo se persuade être rentré en contact avec Léopoldine, sa fille défunte. Les mystères de la mort, de l'au-delà finissent par l'obséder au point d'influencer sa conception de la poésie.
A ses yeux le poète est un être d'exception, extralucide, et donc capable de percer les secrets qui se cachent sous l'apparence des choses.
En particulier la voix des âmes mortes, des spectres qui continuent d'hanter le royaume des vivants...
Bref le poète est un mage, affirmera Hugo, un prophète qui doit éclairer ses frères humains en partageant ses visions au travers de ses vers.
Donc s'il est question de « mémoires », ce n'est plus seulement en lien avec l'Histoire des sociétés, sur un plan politique comme pour les Châtiments, mais avec une Histoire plus grande encore !
Une Histoire universelle, touchant l'Humanité toute entière, celle des vivants comme des morts, des exilés politiques comme des enfants défunts !
Après tout, quand on y réfléchit, l'« âme », c'est aussi ce qui survit après la mort dans la culture occidentale, de la mythologie grecque à la religion chrétienne. L'« âme » est la part immatérielle de la personne, censée passer dans l'au-delà, pour rejoindre le paradis ou l'enfer, ou encore traîner sur terre et hanter les vivants.
D'où ce lien fort avec l'idée de mort ; et cette réorganisation du recueil, à partir de 1853, autour de la date fatale, en mémoire de Léopoldine. La tragédie personnelle ouvre la conscience d'Hugo aux mystères universels de la vie et de la mort...
V. Le mot de la fin : « une », carrément...
Où en est-on ?
« âme », on a rattaché ça à la sensibilité lyrique.
« mémoires », on a vu le lien avec la dimension autobiographique à laquelle manquait l'aspect historique cependant...
Mais avec la mort de Léopoldine et l'idée d'une poésie extralucide, on se rend compte que c'est à une Histoire plus grande encore que se rattache les Contemplations.
Mais on peut affiner encore !
Donc, comme les derniers des singes, on va retourner gratter l'énoncé du thème au programme : « les mémoires d'une âme ».
Que remarques-tu ?
Rien ?
Exactement !
Il reste un mot, un mot de rien du tout, un mot insignifiant. Le genre de mot qu'on ne remarque qu'au neuvième épisode de la saison 1 mais qui décide de toute la saison 2...
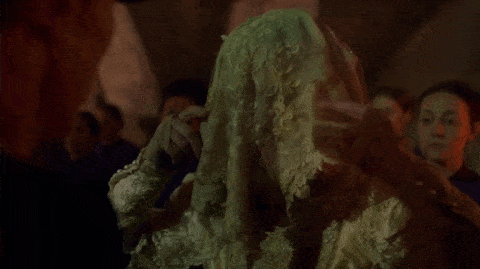
Entre « mémoires » et « âme », il nous reste « une ».
…
Hugo ne parle pas des mémoires de « son » âme ; pas plus qu'il ne parle des mémoires de « l' »âme
Vu l'aspect autobiographique qui passe par le registre lyrique, on aurait pu s'attendre à ce qu'il parle de « son » âme, mais non...
« une » âme, c'est à dire « une » âme indéfinie, « une » âme parmi d'autres. Ca pourrait « son » âme comme ça pourrait être « ton » âme ou l'âme du voisin. N'importe quelle âme !
Et là encore, on va faire simple. Cette expression « les mémoires d'une âme », elle est tirée de la préface des Contemplations en fait. Ce n'est pas l'Education nationale et Mister Bac qui sont derrière ; c'est Victor Hugo lui-même.
Et il suffit d'écouter la suite pour tout comprendre (oe on aurait pu le faire plus tôt, j'avoue...)

« Une destinée est écrite là jour à jour.
Est-ce donc la vie d’un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la destinée est une. Prenez donc ce miroir, et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! »
Nobody :
Hugo :

Okay, maintenant on tient toutes les pièces du puzzle...
Les Contemplations partent d'éléments autobiographiques, dont le deuil de Léopoldine notamment mais pas seulement.
Cependant cette matière autobiographique est transformée par le lyrisme poétique : pour l'auteur, il ne s'agit pas de raconter simplement sa vie mais de communier avec le lecteur sur un plan émotionnel.
Dans le lyrisme leurs émotions et souffrances se confondent ; c'est-à-dire que les sentiments personnels d'Hugo acquièrent une portée universelle.
D'où l'idée de « destinée » : tous les hommes empruntent un chemin semblable, qui va des folies d'une jeunesse insouciante aux lassitudes d'une maturité angoissée par la mort.
Qu'importe ce que chacun fait dans le détail : ultimement tous les parcours, toutes les biographiques se résumeront à cette destinée commune, celle des Mortels !
Donc parler de sa vie à soi, à condition de lui donner un authentique souffle lyrique, permet de mettre à jour la vie de tous les êtres-humains.
Cela permet de tracer une Histoire universelle où jouent les grandes questions existentielles (l'amour, la lutte, la mort, Dieu etc.)
Eléments autobiographique + registre lyrique = l'âme « une » et universelle de l'Humanité.
T'as capté ?
De là, cette idée des « mémoires d'une âme » qui implique l'autobiographie, le lyrisme et la quête du sens universel de l'existence humaine.
Or, maintenant qu'on voit comment articuler toutes ces notions entre elles, on peut anticiper très simplement tous les sujets concernant Victor Hugo.
C'est pas compliqué : on voit que ce qu'il y a de problématique dans c'tte affaire, c'est l'opposition entre le personnel et l'universel.
Les Contemplations racontent la vie d'Hugo mais en même temps ça parle de la vie de tous les hommes. Il y expriment ses sentiments intimes mais ce sont des sentiments qu'on aura tous à vivre un jour.
Donc, le plan suivant un raisonnement dialectique sera plus ou moins toujours le même :
1 Oui!
Les Contemplations ont bien une dimension autobiographique.
2 Mais en même temps...
Elles mettent en avant un lyrisme non-autobiographique.
3 En fait...
Au-delà de l'autobiographie personnelle, elle vise avant tout un questionnement universel.
Pour approfondir ces éléments, voilà de quoi méditer : 2h de sujets de dissertation, décortiqués sans fraude aucune...