Le Pont Mirabeau : entre modernité poétique et tradition lyrique - Guillaume Apollinaire
Aujourd'hui on se penche sur un monument de la littérature française...

Cherche pas : c'est bien le pont...
Et quel pont... 137 mètres de prouesse architecturale et sidérurgique, le premier en son genre, tout en acier, à enjamber la Seine, inauguré à la veille du nouveau siècle, en 1897 !

Dément.
Mais ce n'est pas tout : l'amateur éclairé aura remarqué cette petite plaque commémorative à la base du pont...

Ok, tu reconnais? C'est pour ça qu'on est là : Apollinaire, ses vers, ses amours et son petit pont. Le vrai pont, tout beau qu'il est, on n'y prêterait même pas attention si le monsieur d'Alcools n'avait pas écrit là-dessus.
Mais le monument est là : car c'est sans doute l'un des poèmes les plus connus du répertoire français, l'un des plus populaires même, réadapté à de nombreuses reprises sous forme de chansons.
On va donc apprendre à le commenter, de part en part, sans rien oublier. Mais pour ce faire payons-nous un petit point sur les notions de base à maitriser avant de s'y engager, sur le Pont Mirabeau...
Pourquoi le Pont Mirabeau?
Un fleuron moderne...

Mister Bac, qui a toujours une idée derrière la tête, t'a donné à lire Alcools d'Apollinaire : le recueil, bien que publié en 1913 seulement, réunit tout un tas de poèmes composés depuis 1898. A cheval entre le XIXème et le XXème siècle, il couvre en vérité un tournant historique : c'est la Belle Epoque, comme le disaient les contemporains, marquée par un essor économique, industriel et technologique sans précédent. Bref, une époque où l'on se sent modernes!
De fait Alcools est habité par un profond désir de modernité!
C'est précisément ce qui a retenu l'attention de Mister Bac quand il a sélectionné cette oeuvre pour son programme de poésie. D'où le parcours associé, "modernité poétique?", qui sert de base pour toutes les dissertations sur Apollinaire...
Or le Pont Mirabeau participe de ce désir de modernité. Comme on l'a vu c'est un pont tout récent et dont l'acier rompt avec la tradition des structures en pierre.
A ce titre, le Pont Mirabeau peut être classé parmi ces paysages urbains typiques d'Alcools : jusqu'alors tenus à l'écart des évocations poétiques, ils sont mis dans les vers d'Apollinaire et magnifiés par sa touche lyrique. Dans le même genre on peut aussi citer la rue industrielle ou les avenues avec omnibus de Zones.
Un souvenir personnel
Mais il est vraisemblable que ce soit une tout autre raison, tout à fait bête, qui ait poussé le poète à privilégier ce pont...
Rhoo le twist...
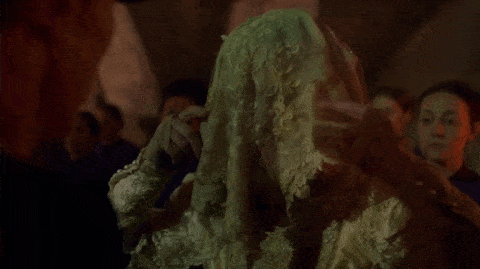
En soi le poème n'est pas tellement centré sur l'évocation des structures d'acier et de l'ingénierie ultramoderne du pont, ça ne t'aura pas échappé... Plus simplement il se contente de retracer une rupture amoureuse, bercé entre le souvenir du bonheur perdu et la douleur de la solitude présente.
Derrière l'évocation poétique, il y a une expérience bien réelle : la rupture de Marie Laurencin, femme peintre, vraisemblablement lassée des crises de colère et de l'alcoolisme du poète (ça y est, tu percutes d'où vient le titre du recueil?...).

...et cela en dépit d'un swagg sans précédent...
En prime une toile du Douanier Rousseau datant de 1909 représentant le couple Marie Laurencin/Guillaume Apollinaire, intitulée : "La Muse inspirant le poète"

Il semblait fait l'un pour l'autre.
L'un semblait même être le sosie de l'autre avec une perruque brune et un rideau bleue en guise de robe.

Du coup le Pont Mirabeau aurait été le passage qu'empruntait les deux amants pour se rendre l'un chez l'autre. C'était le lien qui les unissait par-delà le fleuve.
Le lyrisme élégiaque
On retombe donc sur nos pattes : là où le lieu semblait caractéristique d'un vif désir de modernité, on se rend compte qu'il n'est qu'une allusion biographique du "je" poétique... Et le geste, de raconter sa vie en vers, est tout ce qu'il y a de plus traditionnel...
Car on reconnaît la recette! Les émotions, le "je" et les vers, souviens-toi...
Nous sommes en plein registre lyrique, exact.
Mais attention, pas n'importe quel lyrisme : le fait est qu'Apollinaire se focalise sur un thème bien précis, le passage du temps, qui voit vieillir et disparaître fatalement tout ce qui peut nous être précieux.
Et l'amour n'y échappe pas, non...

Ce faisant, en exprimant sa mélancolie amoureuse dans sa dimension temporelle, avec le thème du souvenir, du passé perdu et de l'attente désespérée, Apollinaire rattache son poème à l'une des plus anciennes traditions lyriques.
E-lé-gie!
L'élégie est une forme de poésie lyrique apparue dans la littérature latine, celle de l'Empire romain donc.
Le "je" poétique y exprime des émotions douloureuses en rapport avec le passé : toutes les formes de tristesse que peut nous causer le caractère irréversible du temps. Cela peut être de la nostalgie (désir impuissant de retourner dans le passé) ou des regrets (désir impuissant de d'agir autrement dans le passé).
Et donc, en conclusion...
Comme souvent dans la poésie d'Apollinaire, Le Pont Mirabeau est un lien qui relie les rives de la tradition et de la modernité, de l'image du renouveau technologique à l'expression de l'élégie antique.
"Alcools : modernité poétique?" on y est en plein dedans. Souviens-t-en pour Mister Bac...
Et maintenant on poursuit par le commentaire détaillé du poème.
Aujourd'hui on se penche sur un monument de la littérature française...

Cherche pas : c'est bien le pont...
Et quel pont... 137 mètres de prouesse architecturale et sidérurgique, le premier en son genre, tout en acier, à enjamber la Seine, inauguré à la veille du nouveau siècle, en 1897 !

Dément.
Mais ce n'est pas tout : l'amateur éclairé aura remarqué cette petite plaque commémorative à la base du pont...

Ok, tu reconnais? C'est pour ça qu'on est là : Apollinaire, ses vers, ses amours et son petit pont. Le vrai pont, tout beau qu'il est, on n'y prêterait même pas attention si le monsieur d'Alcools n'avait pas écrit là-dessus.
Mais le monument est là : car c'est sans doute l'un des poèmes les plus connus du répertoire français, l'un des plus populaires même, réadapté à de nombreuses reprises sous forme de chansons.
On va donc apprendre à le commenter, de part en part, sans rien oublier. Mais pour ce faire payons-nous un petit point sur les notions de base à maitriser avant de s'y engager, sur le Pont Mirabeau...
Pourquoi le Pont Mirabeau?
Un fleuron moderne...

Mister Bac, qui a toujours une idée derrière la tête, t'a donné à lire Alcools d'Apollinaire : le recueil, bien que publié en 1913 seulement, réunit tout un tas de poèmes composés depuis 1898. A cheval entre le XIXème et le XXème siècle, il couvre en vérité un tournant historique : c'est la Belle Epoque, comme le disaient les contemporains, marquée par un essor économique, industriel et technologique sans précédent. Bref, une époque où l'on se sent modernes!
De fait Alcools est habité par un profond désir de modernité!
C'est précisément ce qui a retenu l'attention de Mister Bac quand il a sélectionné cette oeuvre pour son programme de poésie. D'où le parcours associé, "modernité poétique?", qui sert de base pour toutes les dissertations sur Apollinaire...
Or le Pont Mirabeau participe de ce désir de modernité. Comme on l'a vu c'est un pont tout récent et dont l'acier rompt avec la tradition des structures en pierre.
A ce titre, le Pont Mirabeau peut être classé parmi ces paysages urbains typiques d'Alcools : jusqu'alors tenus à l'écart des évocations poétiques, ils sont mis dans les vers d'Apollinaire et magnifiés par sa touche lyrique. Dans le même genre on peut aussi citer la rue industrielle ou les avenues avec omnibus de Zones.
Un souvenir personnel
Mais il est vraisemblable que ce soit une tout autre raison, tout à fait bête, qui ait poussé le poète à privilégier ce pont...
Rhoo le twist...
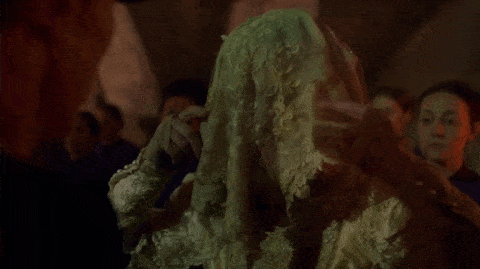
En soi le poème n'est pas tellement centré sur l'évocation des structures d'acier et de l'ingénierie ultramoderne du pont, ça ne t'aura pas échappé... Plus simplement il se contente de retracer une rupture amoureuse, bercé entre le souvenir du bonheur perdu et la douleur de la solitude présente.
Derrière l'évocation poétique, il y a une expérience bien réelle : la rupture de Marie Laurencin, femme peintre, vraisemblablement lassée des crises de colère et de l'alcoolisme du poète (ça y est, tu percutes d'où vient le titre du recueil?...).

...et cela en dépit d'un swagg sans précédent...
En prime une toile du Douanier Rousseau datant de 1909 représentant le couple Marie Laurencin/Guillaume Apollinaire, intitulée : "La Muse inspirant le poète"

Il semblait fait l'un pour l'autre.
L'un semblait même être le sosie de l'autre avec une perruque brune et un rideau bleue en guise de robe.

Du coup le Pont Mirabeau aurait été le passage qu'empruntait les deux amants pour se rendre l'un chez l'autre. C'était le lien qui les unissait par-delà le fleuve.
Le lyrisme élégiaque
On retombe donc sur nos pattes : là où le lieu semblait caractéristique d'un vif désir de modernité, on se rend compte qu'il n'est qu'une allusion biographique du "je" poétique... Et le geste, de raconter sa vie en vers, est tout ce qu'il y a de plus traditionnel...
Car on reconnaît la recette! Les émotions, le "je" et les vers, souviens-toi...
Nous sommes en plein registre lyrique, exact.
Mais attention, pas n'importe quel lyrisme : le fait est qu'Apollinaire se focalise sur un thème bien précis, le passage du temps, qui voit vieillir et disparaître fatalement tout ce qui peut nous être précieux.
Et l'amour n'y échappe pas, non...

Ce faisant, en exprimant sa mélancolie amoureuse dans sa dimension temporelle, avec le thème du souvenir, du passé perdu et de l'attente désespérée, Apollinaire rattache son poème à l'une des plus anciennes traditions lyriques.
E-lé-gie!
L'élégie est une forme de poésie lyrique apparue dans la littérature latine, celle de l'Empire romain donc.
Le "je" poétique y exprime des émotions douloureuses en rapport avec le passé : toutes les formes de tristesse que peut nous causer le caractère irréversible du temps. Cela peut être de la nostalgie (désir impuissant de retourner dans le passé) ou des regrets (désir impuissant de d'agir autrement dans le passé).
Et donc, en conclusion...
Comme souvent dans la poésie d'Apollinaire, Le Pont Mirabeau est un lien qui relie les rives de la tradition et de la modernité, de l'image du renouveau technologique à l'expression de l'élégie antique.
"Alcools : modernité poétique?" on y est en plein dedans. Souviens-t-en pour Mister Bac...
Et maintenant on poursuit par le commentaire détaillé du poème.
Le Pont Mirabeau : entre modernité poétique et tradition lyrique - Guillaume Apollinaire
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine.
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine.
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Le Pont Mirabeau : entre modernité poétique et tradition lyrique - Guillaume Apollinaire
I. Passé amoureux
1. Rupture
Première strophe : d'emblée le poème est placé sous le signe de la rupture.
Dimension temporelle très forte : association de l'amour, de l'écoulement du fleuve et du temps qui passe + ouverture progressive à partir du présent de vérité général au passé mémoriel (mention du souvenir puis imparfait de répétition).
Motif métrique de l'alexandrin brisé, redoublé par l'indétermination grammaticale (« et nos amours », sujet coordonné de « coule » ou complément de « souvienne ») et souligné par le schéma de rimes → incarnation au cœur du texte de l'idée de rupture.
Opposition forte d'un présent malheureux et d'un passé heureux : antithèse « joie »/« peine », avec appui de l'adverbe de temps « toujours », marquant le bonheur idyllique ; en écho douleur dans la réticence face au souvenir (forme interrogative « faut-il ») et la langueur mélancolique (assonance en « ou »).
La première strophe souligne le sentiment de perte d'un bonheur idyllique.
2. Souvenir
Deuxième strophe : cette remémoration douloureuse ouvre la voie d'une actualisation du lien amoureux.
Réalité biographique : le Pont Mirabeau à mi-chemin entre les logements d'Apollinaire et de Marie Laurencin → lien entre 2 rives = lien entre 2 personnes, d'où les figures de redoublement « mains dans les mains » et « face à face » + métaphore « le pont de nos bras » associant la relation amoureuse et la stabilité de la structure architecturale.
Mais s'y oppose l'écoulement permanent : cassure de l'alexandrin créant un enjambement fort (séparation d'une préposition « sous » et du GN « le pont de nos bras ») + inversion du verbe (« passe ») et du sujet « l'onde », isolé en fin de strophe → accélération de la lecture syntaxique, comme emportée par le rythme des vers, et donc le passage du temps.
D'où une résistance du poète voulant préserver le lien : impératif à la première personne du pluriel (« je » lyrique + la bien-aimée) + accents plaintifs avec l'assonance de nasales en « -in » + hypallage double (« regards » « onde » échangent leurs qualificatifs « éternels » et « lasse » : en fait c'est le flux qui ne s'arrête jamais et les regards qui deviennent las) comme le souhait que l'amour soit plus fort que le temps.
L'immersion dans le souvenir n'est pas exempte d'une conscience tragique du temps qui passe.
II. Amour passé
1. Douleur
Troisième strophe : la séparation est donc réaffirmée au présent, sur un mode impersonnel cependant.
Disparition de l'amour, accentuée par l'anaphore, // disparition des pronoms personnels (« je » et « tu ») → article défini généralisant (l'amour, la vie) jusqu'à l'allégorie avec majuscule « l'Espérance » (écho de la poésie médiévale), quête d'un lyrisme à valeur universelle que chaque lecteur puisse faire sien ; mais indice du démonstratif « cette » comme si le poète méditait en regardant la Seine depuis le Pont Mirabeau.
Coupure de l'alexandrin sans rupture syntaxique contrairement aux 2 autres strophes → monotonie // anaphores répétitives + figures de comparaison avec « comme » qui mettent tout au même niveau (départ de l'amour = eau courante = lenteur de la vie = violence de l'Espérance) → impression de lassitude.
Pourtant accent sur la vive souffrance : syllepse du « comme » (2 lectures grâce à l'absence de ponctuation, soit terme de comparaison, soit terme exclamatif « comme la vie est lente ! »), d'où le cri du coeur implicite avec 2 exclamatives possibles + paranomase (ressemblance sonore : « vie est lente » // « vi-o-lente » marqué par une diérèse à cause de l'alexandrin) associant le sentiment de lassitude (« lenteur ») et de douleur (« vi-o-lente », renforcé par le son désagréable de la diérèse) : l'apathie cache une profonde souffrance (typique de la dépression).
La séparation marqué par la perte des pronoms débouche sur l'expression lyrique du désespoir.
2. Épilogue
Quatrième strophe: cet émoi lyrique face à la solitude débouche sur un enseignement à valeur universelle.
Décontextualisation complètes des énoncés : plus de pronoms personnels, plus de démonstratif + présent d'énonciation → présent de vérité générale + généralisation avec absence d'article (« ni temps passé ») ou pluriels (« les amours ») → l'émotion lyrique excède le « je » et se fait expérience universelle.
Fatalité du temps : ampleur de l'écoulement avec la gradation « jours » puis « semaines » + anaphore des négations pour marteler l'idée fatale de perte + insistance sur le thème du passage avec répétition et polyptote (emploi de mots de la même famille, ici « passent » + « passé ») + reprise du 1er vers où le fleuve = le temps, s'écoulant sans fin, d'un bout à l'autre du poème, seule chose qui reste en définitive.
La dépersonnalisation lyrique permet d'accentuer l'idée de désunion et de solitude tout en donnant une portée universelle à l'expérience amoureuse.
3. Éternité
Refrain (attention, il faudra expliquer avoir préféré commenter cette partie à la toute fin parce qu'elle prend sens par rapport à l'ensemble du poème) : marquant un cycle temporel, le refrain est donc un élément crucial de ce lyrisme élégiaque.
Double inspiration de la chanson de toile médiévale (poésie amoureuse chantée par des épouses attendant le retour de leurs conjoints) et de la chanson populaire, marquant l'ambivalence d'Apollinaire à la fois traditionnel et moderne.
Effacement progressif des unités temporelles : d'abord décompte fatidique avec singuliers (« la nuit », « l'heure »), puis démultiplication avec le pluriel (« les jours ») et enfin la permanence du « je » touchant à l'éternité sans unité de mesure + emploi du subjonctif à la 3ème personne → indifférence du poète face à l'écoulement du temps, voire lassitude du temps présent (//dépression), d'où réaffirmation forte de la parole poétique (« je demeure » seul emploi du « je » lyrique en position de sujet) → dimension éternelle supérieure au temps qui passe et à ses souffrances.
→ d'où la forme du refrain donc, scandant cette permanence lyrique par-delà la progression tragique de l'histoire d'amour, du souvenir à la rupture puis à la solitude.
Au fil des refrains, le « je » lyrique et éternel s'affirme comme échappatoire à la douleur élégiaque du temps qui passe et anéantit tout.
I. Passé amoureux
1. Rupture
Première strophe : d'emblée le poème est placé sous le signe de la rupture.
Dimension temporelle très forte : association de l'amour, de l'écoulement du fleuve et du temps qui passe + ouverture progressive à partir du présent de vérité général au passé mémoriel (mention du souvenir puis imparfait de répétition).
Motif métrique de l'alexandrin brisé, redoublé par l'indétermination grammaticale (« et nos amours », sujet coordonné de « coule » ou complément de « souvienne ») et souligné par le schéma de rimes → incarnation au cœur du texte de l'idée de rupture.
Opposition forte d'un présent malheureux et d'un passé heureux : antithèse « joie »/« peine », avec appui de l'adverbe de temps « toujours », marquant le bonheur idyllique ; en écho douleur dans la réticence face au souvenir (forme interrogative « faut-il ») et la langueur mélancolique (assonance en « ou »).
La première strophe souligne le sentiment de perte d'un bonheur idyllique.
2. Souvenir
Deuxième strophe : cette remémoration douloureuse ouvre la voie d'une actualisation du lien amoureux.
Réalité biographique : le Pont Mirabeau à mi-chemin entre les logements d'Apollinaire et de Marie Laurencin → lien entre 2 rives = lien entre 2 personnes, d'où les figures de redoublement « mains dans les mains » et « face à face » + métaphore « le pont de nos bras » associant la relation amoureuse et la stabilité de la structure architecturale.
Mais s'y oppose l'écoulement permanent : cassure de l'alexandrin créant un enjambement fort (séparation d'une préposition « sous » et du GN « le pont de nos bras ») + inversion du verbe (« passe ») et du sujet « l'onde », isolé en fin de strophe → accélération de la lecture syntaxique, comme emportée par le rythme des vers, et donc le passage du temps.
D'où une résistance du poète voulant préserver le lien : impératif à la première personne du pluriel (« je » lyrique + la bien-aimée) + accents plaintifs avec l'assonance de nasales en « -in » + hypallage double (« regards » « onde » échangent leurs qualificatifs « éternels » et « lasse » : en fait c'est le flux qui ne s'arrête jamais et les regards qui deviennent las) comme le souhait que l'amour soit plus fort que le temps.
L'immersion dans le souvenir n'est pas exempte d'une conscience tragique du temps qui passe.
II. Amour passé
1. Douleur
Troisième strophe : la séparation est donc réaffirmée au présent, sur un mode impersonnel cependant.
Disparition de l'amour, accentuée par l'anaphore, // disparition des pronoms personnels (« je » et « tu ») → article défini généralisant (l'amour, la vie) jusqu'à l'allégorie avec majuscule « l'Espérance » (écho de la poésie médiévale), quête d'un lyrisme à valeur universelle que chaque lecteur puisse faire sien ; mais indice du démonstratif « cette » comme si le poète méditait en regardant la Seine depuis le Pont Mirabeau.
Coupure de l'alexandrin sans rupture syntaxique contrairement aux 2 autres strophes → monotonie // anaphores répétitives + figures de comparaison avec « comme » qui mettent tout au même niveau (départ de l'amour = eau courante = lenteur de la vie = violence de l'Espérance) → impression de lassitude.
Pourtant accent sur la vive souffrance : syllepse du « comme » (2 lectures grâce à l'absence de ponctuation, soit terme de comparaison, soit terme exclamatif « comme la vie est lente ! »), d'où le cri du coeur implicite avec 2 exclamatives possibles + paranomase (ressemblance sonore : « vie est lente » // « vi-o-lente » marqué par une diérèse à cause de l'alexandrin) associant le sentiment de lassitude (« lenteur ») et de douleur (« vi-o-lente », renforcé par le son désagréable de la diérèse) : l'apathie cache une profonde souffrance (typique de la dépression).
La séparation marqué par la perte des pronoms débouche sur l'expression lyrique du désespoir.
2. Épilogue
Quatrième strophe: cet émoi lyrique face à la solitude débouche sur un enseignement à valeur universelle.
Décontextualisation complètes des énoncés : plus de pronoms personnels, plus de démonstratif + présent d'énonciation → présent de vérité générale + généralisation avec absence d'article (« ni temps passé ») ou pluriels (« les amours ») → l'émotion lyrique excède le « je » et se fait expérience universelle.
Fatalité du temps : ampleur de l'écoulement avec la gradation « jours » puis « semaines » + anaphore des négations pour marteler l'idée fatale de perte + insistance sur le thème du passage avec répétition et polyptote (emploi de mots de la même famille, ici « passent » + « passé ») + reprise du 1er vers où le fleuve = le temps, s'écoulant sans fin, d'un bout à l'autre du poème, seule chose qui reste en définitive.
La dépersonnalisation lyrique permet d'accentuer l'idée de désunion et de solitude tout en donnant une portée universelle à l'expérience amoureuse.
3. Éternité
Refrain (attention, il faudra expliquer avoir préféré commenter cette partie à la toute fin parce qu'elle prend sens par rapport à l'ensemble du poème) : marquant un cycle temporel, le refrain est donc un élément crucial de ce lyrisme élégiaque.
Double inspiration de la chanson de toile médiévale (poésie amoureuse chantée par des épouses attendant le retour de leurs conjoints) et de la chanson populaire, marquant l'ambivalence d'Apollinaire à la fois traditionnel et moderne.
Effacement progressif des unités temporelles : d'abord décompte fatidique avec singuliers (« la nuit », « l'heure »), puis démultiplication avec le pluriel (« les jours ») et enfin la permanence du « je » touchant à l'éternité sans unité de mesure + emploi du subjonctif à la 3ème personne → indifférence du poète face à l'écoulement du temps, voire lassitude du temps présent (//dépression), d'où réaffirmation forte de la parole poétique (« je demeure » seul emploi du « je » lyrique en position de sujet) → dimension éternelle supérieure au temps qui passe et à ses souffrances.
→ d'où la forme du refrain donc, scandant cette permanence lyrique par-delà la progression tragique de l'histoire d'amour, du souvenir à la rupture puis à la solitude.
Au fil des refrains, le « je » lyrique et éternel s'affirme comme échappatoire à la douleur élégiaque du temps qui passe et anéantit tout.
I. Passé amoureux
1. Rupture
Première strophe : d'emblée le poème est placé sous le signe de la rupture.
Dimension temporelle très forte : association de l'amour, de l'écoulement du fleuve et du temps qui passe + ouverture progressive à partir du présent de vérité général au passé mémoriel (mention du souvenir puis imparfait de répétition).
Motif métrique de l'alexandrin brisé, redoublé par l'indétermination grammaticale (« et nos amours », sujet coordonné de « coule » ou complément de « souvienne ») et souligné par le schéma de rimes → incarnation au cœur du texte de l'idée de rupture.
Opposition forte d'un présent malheureux et d'un passé heureux : antithèse « joie »/« peine », avec appui de l'adverbe de temps « toujours », marquant le bonheur idyllique ; en écho douleur dans la réticence face au souvenir (forme interrogative « faut-il ») et la langueur mélancolique (assonance en « ou »).
La première strophe souligne le sentiment de perte d'un bonheur idyllique.
2. Souvenir
Deuxième strophe : cette remémoration douloureuse ouvre la voie d'une actualisation du lien amoureux.
Réalité biographique : le Pont Mirabeau à mi-chemin entre les logements d'Apollinaire et de Marie Laurencin → lien entre 2 rives = lien entre 2 personnes, d'où les figures de redoublement « mains dans les mains » et « face à face » + métaphore « le pont de nos bras » associant la relation amoureuse et la stabilité de la structure architecturale.
Mais s'y oppose l'écoulement permanent : cassure de l'alexandrin créant un enjambement fort (séparation d'une préposition « sous » et du GN « le pont de nos bras ») + inversion du verbe (« passe ») et du sujet « l'onde », isolé en fin de strophe → accélération de la lecture syntaxique, comme emportée par le rythme des vers, et donc le passage du temps.
D'où une résistance du poète voulant préserver le lien : impératif à la première personne du pluriel (« je » lyrique + la bien-aimée) + accents plaintifs avec l'assonance de nasales en « -in » + hypallage double (« regards » « onde » échangent leurs qualificatifs « éternels » et « lasse » : en fait c'est le flux qui ne s'arrête jamais et les regards qui deviennent las) comme le souhait que l'amour soit plus fort que le temps.
L'immersion dans le souvenir n'est pas exempte d'une conscience tragique du temps qui passe.
II. Amour passé
1. Douleur
Troisième strophe : la séparation est donc réaffirmée au présent, sur un mode impersonnel cependant.
Disparition de l'amour, accentuée par l'anaphore, // disparition des pronoms personnels (« je » et « tu ») → article défini généralisant (l'amour, la vie) jusqu'à l'allégorie avec majuscule « l'Espérance » (écho de la poésie médiévale), quête d'un lyrisme à valeur universelle que chaque lecteur puisse faire sien ; mais indice du démonstratif « cette » comme si le poète méditait en regardant la Seine depuis le Pont Mirabeau.
Coupure de l'alexandrin sans rupture syntaxique contrairement aux 2 autres strophes → monotonie // anaphores répétitives + figures de comparaison avec « comme » qui mettent tout au même niveau (départ de l'amour = eau courante = lenteur de la vie = violence de l'Espérance) → impression de lassitude.
Pourtant accent sur la vive souffrance : syllepse du « comme » (2 lectures grâce à l'absence de ponctuation, soit terme de comparaison, soit terme exclamatif « comme la vie est lente ! »), d'où le cri du coeur implicite avec 2 exclamatives possibles + paranomase (ressemblance sonore : « vie est lente » // « vi-o-lente » marqué par une diérèse à cause de l'alexandrin) associant le sentiment de lassitude (« lenteur ») et de douleur (« vi-o-lente », renforcé par le son désagréable de la diérèse) : l'apathie cache une profonde souffrance (typique de la dépression).
La séparation marqué par la perte des pronoms débouche sur l'expression lyrique du désespoir.
2. Épilogue
Quatrième strophe: cet émoi lyrique face à la solitude débouche sur un enseignement à valeur universelle.
Décontextualisation complètes des énoncés : plus de pronoms personnels, plus de démonstratif + présent d'énonciation → présent de vérité générale + généralisation avec absence d'article (« ni temps passé ») ou pluriels (« les amours ») → l'émotion lyrique excède le « je » et se fait expérience universelle.
Fatalité du temps : ampleur de l'écoulement avec la gradation « jours » puis « semaines » + anaphore des négations pour marteler l'idée fatale de perte + insistance sur le thème du passage avec répétition et polyptote (emploi de mots de la même famille, ici « passent » + « passé ») + reprise du 1er vers où le fleuve = le temps, s'écoulant sans fin, d'un bout à l'autre du poème, seule chose qui reste en définitive.
La dépersonnalisation lyrique permet d'accentuer l'idée de désunion et de solitude tout en donnant une portée universelle à l'expérience amoureuse.
3. Éternité
Refrain (attention, il faudra expliquer avoir préféré commenter cette partie à la toute fin parce qu'elle prend sens par rapport à l'ensemble du poème) : marquant un cycle temporel, le refrain est donc un élément crucial de ce lyrisme élégiaque.
Double inspiration de la chanson de toile médiévale (poésie amoureuse chantée par des épouses attendant le retour de leurs conjoints) et de la chanson populaire, marquant l'ambivalence d'Apollinaire à la fois traditionnel et moderne.
Effacement progressif des unités temporelles : d'abord décompte fatidique avec singuliers (« la nuit », « l'heure »), puis démultiplication avec le pluriel (« les jours ») et enfin la permanence du « je » touchant à l'éternité sans unité de mesure + emploi du subjonctif à la 3ème personne → indifférence du poète face à l'écoulement du temps, voire lassitude du temps présent (//dépression), d'où réaffirmation forte de la parole poétique (« je demeure » seul emploi du « je » lyrique en position de sujet) → dimension éternelle supérieure au temps qui passe et à ses souffrances.
→ d'où la forme du refrain donc, scandant cette permanence lyrique par-delà la progression tragique de l'histoire d'amour, du souvenir à la rupture puis à la solitude.
Au fil des refrains, le « je » lyrique et éternel s'affirme comme échappatoire à la douleur élégiaque du temps qui passe et anéantit tout.