La Loreley : la tradition romantique au service de l'Esprit nouveau ? - Guillaume Apollinaire
Ah...
Le poète en plein coeur...
Apollinaire et ses muses, Apollinaire et les femmes...
Dieu merci, Mister BAC n'est pas tellement allé gratter de ce côté-là, avec son parcours « Modernité poétique ? ». Parce qu'en définitive, en ce qui concerne son rapport au féminin, le bilan n'est pas très reluisant, si vous voulez mon avis. Ce n'est pas tant les déconvenues et les vestes que se paie Apollinaire qui importent, mais plus généralement son rapport maladif avec la gent féminine, toxique pourrait-on dire.
Et toxique littéralement, dans Colchiques, où la fleur emblématique de la bien-aimée n'est plus la rose, mais le colchique, dont on tirait du poison durant l'antiquité.
Apo, ravale donc ta rancoeur et recrache ton colchique de venin...
Car comme nombre de poètes, Apollinaire entretient des relations de couple passablement conflictuelles : il y a les femmes qu'il effraie avec ses grands sentiments, en quête d'un amour fusionnel et absolu, et puis il y a celles qui n'en peuvent plus de son obsessionnelle jalousie, d'autant plus qu'il l'épiçait à coups de vin rouge comme le racontait Marie Laurencin.
Bref, c'est le coup classique du désir masculiniste, qui voudrait enfermer sa bien-aimée dans un idéal et se finit sur une méchante diabolisation où le genre tout entier se fait victimiser.
Je le dis comme je le pense. Bienvenue sur Archiprof poto !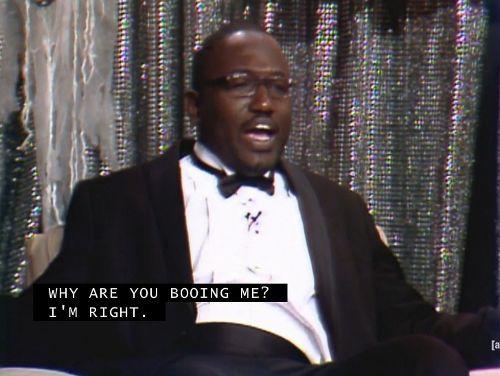
Mais je dois avouer que La Loreley sort du lot en la matière !
Même s'il faut relever toujours cette maladive association du genre féminin, de ses charmes à l'idée de maléfice et de sorcellerie, on peut noter que le poème renverse précisément cet état de fait, en approfondissant le point de vue féminin et en interrogeant la malédiction dont la Loreley est frappée...
Une malédiction qui n'est autre que le désir masculin en fin de compte !
Bon, on est loin du féminisme bien sûr ; mais il y a là une certaine conscience du poète qui dénote avec les récriminations habituelles du bon coeur abandonné, du mal aimé, du nice guy qui campe sur son pont Mirabeau etc.
Ensuite, sans chercher à enfoncer aucunement le poto Apo, il faut rappeler qu'il s'agit d'une réécriture, largement inspiré par la version romantique et allemande qui mettait déjà en avant cette lecture du personnage, victime de l'injustice des hommes, ceux qui se laisse trop vite séduire comme ceux qui n'ont pas assez de coeur pour cela.
Au moins, Apollinaire quand il part à l'étranger en touriste, il apprend des trucs ; ensuite ça fait lui autre chose que des posts et filtres à partager !

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
La Loreley : la tradition romantique au service de l'Esprit nouveau ? - Guillaume Apollinaire
À Bacharach il y avait une sorcière blonde
Qui laissait mourir d’amour tous les hommes à la ronde
Devant son tribunal l’évêque la fit citer
D’avance il l’absolvit à cause de sa beauté
Ô belle Loreley aux yeux pleins de pierreries
De quel magicien tiens-tu ta sorcellerie
Je suis lasse de vivre et mes yeux sont maudits
Ceux qui m’ont regardé évêque en ont péri
Mes yeux ce sont des flammes et non des pierreries
Jetez jetez aux flammes cette sorcellerie
Je flambe dans ces flammes ô belle Loreley
Qu’un autre te condamne tu m’as ensorcelé
Évêque vous riez Priez plutôt pour moi la Vierge
Faites-moi donc mourir et que Dieu vous protège
Mon amant est parti pour un pays lointain
Faites-moi donc mourir puisque je n’aime rien
Mon cœur me fait si mal il faut bien que je meure
Si je me regardais il faudrait que j’en meure
Mon cœur me fait si mal depuis qu’il n’est plus là
Mon cœur me fit si mal du jour où il s’en alla
L’évêque fit venir trois chevaliers avec leurs lances
Menez jusqu’au couvent cette femme en démence
Va-t’en Lore en folie va Lore aux yeux tremblants
Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc
Puis ils s’en allèrent sur la route tous les quatre
La Loreley les implorait et ses yeux brillaient comme des astres
Chevaliers laissez-moi monter sur ce rocher si haut
Pour voir une fois encore mon beau château
Pour me mirer une fois encore dans le fleuve
Puis j’irai au couvent des vierges et des veuves
Là-haut le vent tordait ses cheveux déroulés
Les chevaliers criaient Loreley Loreley
Tout là-bas sur le Rhin s’en vient une nacelle
Et mon amant s’y tient il m’a vue il m’appelle
Mon cœur devient si doux c’est mon amant qui vient
Elle se penche alors et tombe dans le Rhin
Pour avoir vu dans l’eau la belle Loreley
Ses yeux couleur du Rhin ses cheveux de soleil

Pas encore inscrit sur Archiprof ? 🙈🙈🙈
👇 Par ici les tips et commentaires... 👇
Clique, et crée un compte pour te mettre bien !
La Loreley : la tradition romantique au service de l'Esprit nouveau ? - Guillaume Apollinaire
#I. Sorcière
##1. Conte romantique Par ses références et sa démarche, le poème se présente d'emblée comme un court récit nourri par la littérature allemande du début du XIXème.
D'EMBLÉE :
A rebours des évocations poétiques d'Apollinaire, ici une mécanique proprement narrative, typique du conte...
-a) incipit traditionnel « Il y avait » du v.1
-b) narration au passé articulant...
- imparfait d'arrière-plan (1er distique)
= contextualisation
- passé simple de premier plan (2e distique)
= élément perturbateur (le procès) accélérant l'action narré au fil des péripéties
-c) dialogue au discours direct ( même si la ponctuation est supprimée )
-> passage au présent et à la 1er et 2e pers. sing)
DONC :
- Un conte donc au lien intertextuel (=en référence à un écrit antécédent)
-> réécriture à partir des poètes romantiques allemands Brentano et Heine
= contexte germanique et médiéval (période fétiche du romantisme)
-> mention de « Bacharach »
= ville au bord du Rhin
-> éléments historiques
= procès en sorcellerie de « l'évêque », « son tribunal » et l'idée d'absolution
+ plus loin la présence des « chevaliers »
-> la Loreley s'inspire du folklore local rhénan
= légende autour d'un rocher culminant sur le Rhin où se fracassait les marins
// visite de la région un été à l'occasion du voyage d'une famille auprès de laquelle il occupait le poste de précepteur
( origine de son amour pour la nourrice anglaise, Annie Playden )
Apollinaire bouscule ainsi ses habitudes en se raccrochant à une tradition étrangère romantique.
##2. Puissance occulte Ce décentrement n'en prolonge pas moins son questionnement sur l'amour et le rapport au féminin.
AINSI :
- Récit centré sur la sorcière Loreley
-> caractère duplice (=double et trompeur) avec « sorcière blonde » au v.1
( chez Apollinaire, blondeur = calme, sérieux, sagesse, cf. Nuit Rhénane, qui oppose blondes « aux nattes repliées » et sorcières aux « cheveux verts et longs » )
+ v.2 : ensorcellement manifesté par l'allongement des sonorités et rythmes
-> 14 temps + allitération en « m » et assonance en « ou » et « on »
= langueur des hommes frappés d'amour, se laissant mourir...
DE MÊME :
- mise en scène de la séduction avec le personnage de l'évêque au 2e distique
-> d'abord attitude énergique avec sons brefs (assonance en « i » et « a »)
/ MAIS : à son tour paranomase
= l'autorité judiciaire « devant » laquelle comparait la sorcière est renversée par le désir d'une union à venir (=« d'avance »)
→ apostrophe emphatique avec le « ô » lyrique et les attributs (« belle » + CDN) très solennels
+ peut-être que la 1er question vise à la déresponsabiliser en incriminant un « magicien » ?
DE LÀ :
- une première interprétation du nom « Loreley » à partir de l'attribut « aux yeux plein de pierreries »
= allemand moderne lauern : guetter, se tenir en embuscade + ley : la pierre
→ le regard où se tient en embuscade un cœur de pierre
( pierreries = beauté froide et dure // idée du minéral )
= idée d'un piège dans la séduction
La femme qu'est Loreley répond dans l'immédiat au lieu commun de l'enchanteresse séductrice dont sont victimes les hommes.
##3. Malédiction renversante Cependant la prise de parole de Loreley, et le partage de son point de vue, permettent de nuancer ce premier regard sur le féminin ensorceleur.
AINSI :
- Affirmation croissante d'une passivité face à la puissance maléfique
-> 4e distique : expression d'une lassitude à la 1er pers. sing.
+ assimilation du mal à « mes yeux »
= distance qui contribue à la déresponsabiliser
+ en position de COD dans le rapport de regard, et non de sujet
= passivité totale, d'où une irresponsabilité
PLUS ENCORE :
- statut de victime
-> 5e distique : réfutation de l'interprétation de l'évêque, avec des « flammes » au lieu des « pierreries »
+ souffrance enserrée par la malédiction (« mes yeux … cette sorcellerie »)
+ violence du ton
= répétition et impératifs pour marquer l'effroi et la douleur
+ comble avec l'anacoluthe
(emploi d'un même mot en 2 sens différents : ici des « flammes » intérieures symbolique aux « flammes » réelles du bûcher )
= continuité de la souffrance psychologique à celle physique
+ supplication pour mettre fin au martyr ( =sincérité désespérée, non manipulation pour se sauver )
MAIS :
- la malédiction perturbe son aveu
-> attitude irresponsable et badine de l'homme de religion
( =qui flirte : nouvelle apostrophe lyrique )
= chiasme du v.11 (A lui B feu / B feu A elle)
-> les deux s'unissent dans les flammes, c'est-à-dire le désir ardent, la concupiscence charnelle
+ chiasme du v.12 (A masculin (sujet) B féminin (COD) / B féminin (sujet) A masculin (COD)
= invocation d'« un autre » indéterminé avec subjonctif ( ici = du virtuel mais non réel )
( l'Évêque confie à un autre l'autorité masculine qu'il a pour sa part perdue, maintenant qu'il n'est qu'un simple objet aux mains du charme féminin... )
+ chiasme centré sur une antithèse du v.13 (A figure religieuse B lui C rire C prière B elle A figure religieuse)
= perte complémentaire du pouvoir et de la foi par l'évêque
// gain d'une dimension sacrée de la femme avec attitude charitable
= formule finale de bénédiction face à la mise à mort
+ autorité des impératifs démultipliés, marquant l'inversion du rapport de force
Contre toute attente les rôles se sont renversés : la séductrice s'est faite sainte martyr, et l'évêque infernal porc !
#II. Amante
##1. Désir féminin Cette métamorphose de Loreley au fil de son témoignage se clôt sur sa confession décisive, une dramatique révélation !
DÈS LORS :
- Après la réfutation du cœur de pierre, la révélation de l'amour tragique !
-> Loreley est une amante éplorée
= polyptote paradoxale avec « mon amant »/« je n'aime rien »
( ici « rien » = être absent, qui n'a « rien » de présent pour ainsi dire )
-> twist ! Elle passait pour séductrice sans cœur parce que tout son cœur se portait vers quelqu'un d'absent, vers une absence !
ALORS :
- Qui est-il ?
->Éloignement double...
-a) spatial
= indétermination du « pays lointain » caractérisé uniquement par la distance
-b) temporel
= transformation...
1. du passé composé « est parti »...
( temps dont l'action démarre dans le passé mais se perpétue jusque dans le présent -idée de lien passé-présent donc )
2. à l'alternative entre la négative au présent « n'est plus là » et l'affirmative au passé simple « s'en alla »
-> l'amant est rejeté dans un passé disjoint du présent, vécu alors comme un manque négatif (« ne... plus »)
D'OÙ :
- expression d'une douleur dramatique...
-a) anaphores enchevêtrées, v.15 et 17
= supplication pour mourir
+ violence de l'impératif renforcé par l'adverbe « donc »
-b) nouvelles anaphores au v.18, 20 et 21
= cri du « coeur », s'affirmant donc à l'encontre de l'accusation des hommes
+ intensif « si »
+ paroles brisées s'émiettant en mots monosyllabiques, comme entrecoupées de sanglots...
La métamorphose de Loreley en sainte débouche ainsi sur l'identification du mal, non celui des maléfices diaboliques mais de la mélancolie des mal-aimés...
##2. Effroi masculin Pourtant cet aveu radical, loin de susciter la compassion de l'évêque ou de prolonger simplement l'ensorcellement amoureux, l'effraie...
SOUDAIN :
- reprise en main de l'évêque
réaffirmation de sa fonction de commandement
= semi-auxiliaire « fit venir » (=ordonner de)
+ démultiplication des impératifs
/ s'opposant et supplantant ceux de Loreley)
+ caractère irrévocable du futur de l'indicatif « tu seras »
→ retour à un ordre fondé sur le pouvoir masculin
= mention symbolique des 3 chevaliers armés
-> dimension symbolique des « lances »)
+ connotation magique du chiffre 3
/ MAIS aussi disproportion ( 3 hommes armés pour 1 femme enchaînée )
-> marque de la terreur masculine face au secret de cette femme fatale !
Un amour de femme !
DE FAIT :
- non-reconnaissance du désir féminin
→ impossible de la condamner au bûcher car...
-a) jeter aux flammes = prolonger les flammes dans son cœur
= référence aux v.10 et 11
-b)= leur donner une visibilité en place publique
-> d'où le choix de cacher et masquer, avec le « couvent »
+ l'idée de vêtir « de noir et de blanc »
( il s'agit de la couvrir de vêtement pour cacher la nudité de son désir à présent avoué )
+ plus loin mention « des veuves et des vierges »
-> blanc = pureté des vierges
-> noir = deuil des veuves
= un lieu loin des hommes, une prison pour femmes afin de protéger l'ordre des hommes
+ désignation masculine du désir passionnel comme « démence » et « folie » travestissant le pur amour
DE LÀ :
- emploi du diminutif « Lore » extrêmement significatif
-> marque d'affection suite à l'ensorcellement ?
-> Répression masculine qui ampute Loreley de son amour en la condamnant ?
-> ou au contraire, retrait de -ley
= la pierre en allemand
// coeur de pierre du v.5
-> Lore seul : étymologiquement, de lureln en dialecte rhénan
= murmure, ici comme expression d'un mal intérieur, une plainte sourde
// la roche Lorelei dans la réalité : roche qui semblait murmurer à cause de l'écho d'une cascade grondante proche
+ reformulation des « yeux plein de pierreries » du v.5 aux « yeux tremblants » du v.24
= de la rigidité minérale au tremblement des flammes
-> comme une reconnaissance indirecte de son désir ?
Face à la révélation du désir féminin, l'ordre masculin incarné par l'évêque tente de reprendre le dessus en l'occultant immédiatement.
#III. Légende
##1. Subversion Au sortir du face-à-face, le récit peut reprendre son cours avec le départ pour le couvent.
DE LÀ :
- Retour à la narration
-> marques du récit avec adverbe « ¨puis » + passé simple
→ idée du cheminement appuyé par le CC de lieu « sur la route »
/ MAIS : obstacle immédiat !
-> supplications de la Loreley
-a) imparfait de durée
= comme freinant l'action
-b) interruption avec le discours direct pour demander un délai
= opposition de la répétition « une fois encore », v.27 et v.28 / futur de l'indicatif « puis j'irai »
/ MAIS : rétablissement de l'ordre
= mise à distance maximale de 2 genres, encadrant les v.26 et v.29
+ nouvelle subversion de l'autorité masculine
= impératif ambigu « laissez-moi monter », reconnaissant la puissance des chevaliers pour mieux la subvertir
→ prise de contrôle du récit qu'elle rythme et détourne de son but initial (le couvent → le rocher).
DE FAIT :
- une Loreley au complet !
-> emploi au v. 25 de l'article défini
= elle acquiert sa dimension légendaire
+ complémentarité des actions et de leurs sujets...
-a) souffrance pathétique de la femme dans la 1er moitié
-b) séduction irrésistible de « ses yeux » maudits dans la 2e moitié
comparaison hyperbole
+ duplicité du jeu de mots peut-être (« des astres » = désastre)
// parallélisme de v.27 et 28 à l'image du reflet sur l'eau...
**-a)**d'un côté l'image du passé
= « mon beau château »
-b) de l'autre l'image de la beauté fatale
= « me mirer », acte narcissique
Toutefois la sanction des hommes ne suffit pas à barrer la légende de Loreley en route vers une destinée qui n'appartient qu'à elle...
##2. Evasion De fait c'est sa liberté que ravit Loreley aux hommes en gravissant le rocher où elle pourra à loisir laisser parler son désir.
ENFIN :
- Indépendance
= distance spatiale et hauteur prise par Loreley
-> intensif pour qualifier le rocher « si haut » au v.26
+ reprise au v.30 avec le CC de lieu « là haut »
→ point culminant
// affranchissement : image des cheveux décoiffés
(cf. opposition dans Nuit rhénane des figures aux nattes blondes et des sorcières aux longs cheveux verts)
+ violence du vent
= verbe « tordait »
+ panique des hommes
= verbe « criaient » et répétition du nom
AINSI :
- Évasion loin de l'ordre masculin et de sa censure du désir féminin
→ hallucination de l'amant
= précision croissante...
-a) du lointain
= CC de lieu avec intensif « tout là bas »)
-b) puis l'approche de la nacelle
-c) puis l'identification de l'être aimé, jusqu'au contact visuel
-d) enfin l'appel
= échos sonores (« s'en vient » / « s'y tient » puis « il m'a vue » / « il m'appelle »)
+ resserrement croissant de ces échos sonores pour marquer l'émotion
D'OÙ :
-> consolation illusoire de Loreley
= sérénité dans le rythme du v.34 avec rime intérieur
+ hyperbole avec intensif « si »
/ en opposition aux « flammes » du v.9
+ extraction (structure grammatical avec « c'est... que... » pour mettre en valeur un élément de la phrase) de « mon amant »
= certitude hallucinatoire.
Pourtant si le désir de Loreley trouve à s'exprimer il n'en demeure pas moins illusoire, et par là-même profondément tragique...
##3. Fonder sa légende
Car Loreley, à l'image du poète, reste une mal-aimée dont la puissance de séduction a pour revers un tragique désespoir.
ALORS :
- Dénouement tragique à la signification double...
-a) noyade qui confirmait le v.19 prophétique
→ figure mythologique de Narcisse sous le charme de son propre reflet
-b) désespoir amoureux conduisant à la mort et à la « métamorphose » en rocher (en lui prêtant son nom)
→ figure associée d'Echo, nymphe désespérément amoureuse de Narcisse mais rejetée par lui
( c'est d'ailleurs ce rejet qui pousse les Dieux à punir Narcisse en le rendant fou amoureux de son reflet )
// Brentano, auteur d'origine (en 1801), s'était inspiré du récit d'Echoe et Narcisse raconté par Ovide dans les Métamorphoses.
D'OÙ :
**-**le lien avec le rocher
= image de la fixité, associée à la légende qui demeure dans la mémoire des gens
+ lien avec le fleuve
= image du passage, associée à l'amour qui n'est pas éternel...
-> « l'amant » qui se déplace sur l'eau
+ lien entre le « Rhin » et le « soleil », au travers des attributs érotiques (« yeux » + « cheveux »)
-> soleil est l'astre qui rythme les journées, et donc le passage du temps !
+ syntaxe fluide des 3 derniers vers, presque des enjambements
= forme qui imite l'écoulement de l'eau, et du temps donc
MAIS DONC :
- ni tout à fait un suicide ?
// à l'image d'Echo qui se laisse dépérir aveuglée par son amour désespéré
+ ni tout à fait une folie
// à l'image de Narcisse qui se noie ensorcelé par sa propre image
-> un acte désespéré pour donner la solidité d'un roc à son amour fuyant ?
= une volonté de prêter à ce désir passager l'éternité propre aux légendes
// écriture poétique d'après Apollinaire qui permet de préserver quelque chose des amours
( cf. Le Pont Mirabeau, où le texte permet au poète d'affirmer « je demeure » quand tout coule avec l'eau de la Seine )
Ainsi s'affirme le pendant tragique et féminin de l'acte par lequel le poète parvient à s'affirmer à l'encontre du passage du temps.

Tu n'as pas le compte Premium !
Si tu souhaites mettre à jour ton compte, pas de problème !
Clique ici, et mets à jour ton compte (onglet : mon abonnement).
